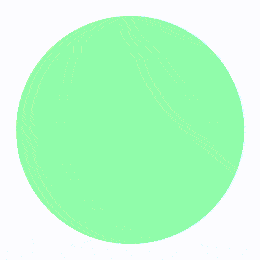ll y a un mois, Elias Studer et Orhan ont obtenu une victoire historique devant le Tribunal fédéral. Ce succès a à son tour encouragé Schuan Tahir à raconter son histoire : il n'a pas été naturalisé parce qu'il a remis sa plaque d'immatriculation trop tard. Ce n'est malheureusement pas une blague. De telles broutilles suffisent aujourd'hui pour refuser une naturalisation. Nous nous engageons pour que cela change dans un avenir proche.
Le reportage de la SRF sur le refus de naturalisation d'un couple de Néerlandais vivant en Suisse depuis 20 ans a également été un triste point culminant de ces dernières semaines. La commune est arrivée à la conclusion que le couple avait certes une réputation irréprochable, des connaissances suffisantes en allemand et une situation personnelle et financière saine. Mais leurs connaissances de la politique et de la commune étaient insuffisantes et iels n'étaient « pas suffisamment intégré·e·s ». Le maire UDC de la commune a déclaré qu'on ne les voyait nulle part dans le village et - attention ! - qu’on ne « sentait » pas que le couple avait du plaisir à être là.
« La joie d’être là » constitue-t-elle un critère de naturalisation ? Bien sûr que non. Dans un Etat de droit, cela ne regarde personne, et les commissions de naturalisation ne devraient pas avoir pour mission principale de « sentir ». Mais en Suisse, le terme d’intégration peut être étiré dans tous les sens pour refuser une naturalisation. L’histoire de Ronny et Saskia montre de manière exemplaire l’« attitude de petit chef de la maison » qui sous-tend la politique de naturalisation suisse. Cela rappelle les empereurs romains : pouce vers le haut ou pouce vers le bas, selon le bon vouloir de chacun, c'est-à-dire de manière complètement arbitraire.
Le reportage de Rundschau critique vivement la commune, montrant que de nombreux habitant·e·s sont incapables de répondre aux questions de la commission de naturalisation. La montagne la plus haute ? La différence entre le Conseil national et le Conseil des Etats ? Tout·e·s ont échoué. Le maire défend les questions posées en comparant la naturalisation à l’examen du permis de conduire : si on se prépare, on réussit. Il y a pourtant une différence. Toutes les personnes souhaitant conduire un véhicule doivent passer l’examen. Or pour obtenir le passeport suisse, la plupart des personnes ne doivent passer aucune épreuve, alors que les autres doivent se soumettre à cette procédure semée d’embûches.
Il n'y a pas que dans les questions de connaissances que les candidat·e·s à la naturalisation doivent prouver plus que le Suisse moyen ou la Suissesse moyenne. Une nouvelle étude basée sur un sondage montre que le respect de certaines normes sociales, typiquement exigées dans le cadre de l'« intégration », est davantage attendu des « étranger·ère·s » que de la société dans son ensemble. La recherche sur la migration nomme cela la « dispense d'intégration » : l'intégration n'est exigée et vérifiée que pour une partie bien déterminée de la population, et pas pour les autres.
Il reste beaucoup à faire sur le chemin d’une vraie démocratie. C’est ce chemin que nous souhaitons parcourir ensemble. Souhaitez-vous nous aider à faire connaître des histoires telles que celles d’Orhan, de Schuan, de Saskia et de Ronny ?
[Faire à don pour la démocratie des quatre quarts]
Merci pour votre soutien !
Action Quatre Quarts